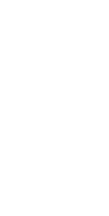- La 4e guerre intercoloniale et le contexte
La déportation des Acadiens, aussi appelée le Grand Dérangement, s’inscrit dans le contexte de la 4e guerre intercoloniale, connue sous le nom de guerre de Sept Ans (1754-1760). Ce conflit oppose les Britanniques aux Français pour le contrôle de l’Amérique du Nord. La victoire britannique ne se limite pas à la conquête de la Nouvelle-France : elle entraîne également la déportation d’environ 10 000 Acadiens sur une population de 15 000 à l’époque, un événement tragique qui a bouleversé la société acadienne.
- L’Acadie, possession britannique depuis 1713
Depuis le traité d’Utrecht en 1713, l’Acadie, comprenant l’actuelle Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard, est sous domination britannique. Les Acadiens, francophones et catholiques, refusent de prêter un serment d’allégeance inconditionnel au roi d’Angleterre, préférant rester neutres dans les conflits entre la France et la Grande-Bretagne. Cette neutralité est perçue comme une menace par les autorités britanniques, surtout dans un contexte de rivalité pour le contrôle du territoire et de ses ressources. Dès les années 1720, des plans d’expulsion sont envisagés, mais ce n’est qu’en 1755 que l’ordre est donné de procéder à la déportation massive.
- Le déroulement et les conséquences de la déportation
La déportation commence à l’été 1755, sous l’ordre du lieutenant-gouverneur Charles Lawrence. Les Britanniques procèdent à la saisie des biens (bétail, outils, habitations), à la destruction des fermes et à la séparation des familles. Les hommes sont souvent déportés en premier, suivis des femmes et des enfants, ce qui accentue la tragédie humaine. Les Acadiens sont dispersés dans l’une ou l’autre des 13 colonies britanniques d’Amérique du Nord, en Grande-Bretagne, en France. Les conditions à bord des navires sont épouvantables : maladies, famine, froid et naufrages causent la mort de milliers de personnes.
Les colonies britanniques, notamment le Massachusetts et la Caroline du Sud, accueillent les réfugiés avec hostilité, votant parfois des lois pour limiter leur déplacement. Certains Acadiens parviennent à s’établir en Louisiane, où ils donneront naissance à la culture cajun, tandis que d’autres cherchent à retourner en Acadie ou se retrouvent en France ou au Québec. Les terres et habitations abandonnées sont attribuées à des colons britanniques, contribuant à l’approvisionnement des troupes pendant la guerre.
- Nettoyage ethnique?
La question de savoir si la déportation des Acadiens constitue un acte de nettoyage ethnique fait débat parmi les historiens. Beaucoup considèrent qu’il s’agit de l’une des premières opérations de ce type à grande échelle dans l’histoire moderne, visant à éliminer une population jugée indésirable pour assurer le contrôle d’un territoire stratégique. D’autres soulignent que l’objectif n’était pas l’extermination, mais la dispersion et l’expulsion des Acadiens pour empêcher tout retour ou toute résistance organisée.
- Une tragédie immortalisée dans la culture
Le drame de la déportation a profondément marqué la mémoire collective acadienne et a inspiré de nombreuses œuvres littéraires et musicales. Le poème « Évangéline » de Henry Wadsworth Longfellow (1847), traduit en français par Pamphile Lemay, raconte la quête d’une Acadienne séparée de son amour lors du Grand Dérangement. La chanson « Évangéline » de Michel Conte (1971) et diverses adaptations musicales et théâtrales, dont une comédie musicale prévue en 2026 à Montréal, Québec et Moncton, perpétuent le souvenir de cette tragédie et sa résonance dans l’identité acadienne.
Luc Guay, Ph.D
Professeur retraité de l’Université de Sherbrooke