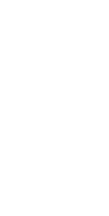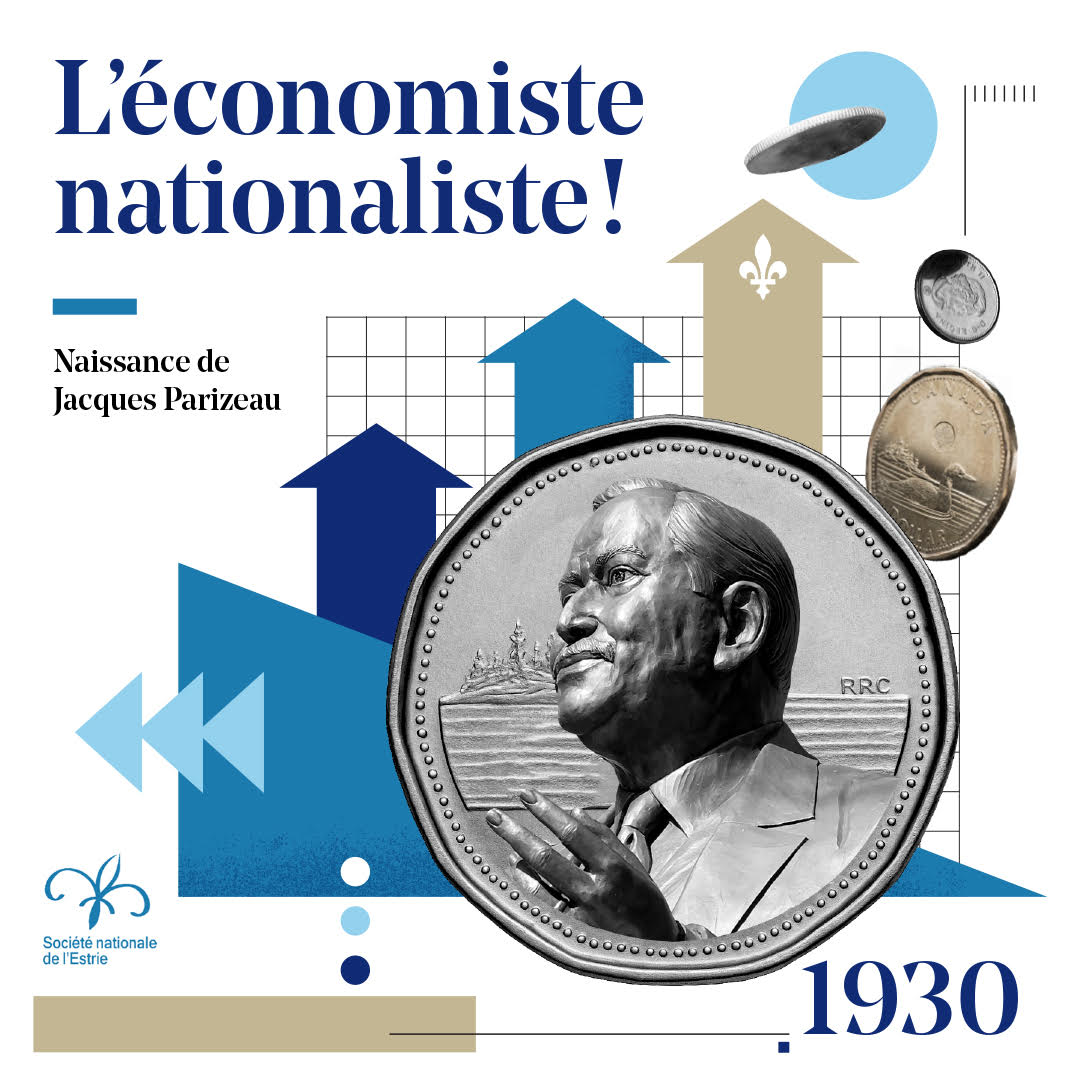Issu de la grande bourgeoise de Montréal, son arrière-grand-père fut un des fondateurs de la chambre de commerce de Montréal, son grand-père, médecin renommé et son père, le bâtisseur de l’une des plus grandes sociétés financières du Québec, Jacques Parizeau fut le premier canadien à obtenir un doctorat à la célèbre London School of Economics de Londres en 1955. Il débuta sa carrière comme professeur aux HEC de Montréal.
- Un économiste aux idées avant-gardistes
Dès les années 1950 il fut un fervent partisan de l’interventionnisme de l’État dans le développement économique du Québec. Ses idées économiques avant-gardistes le placèrent parmi les principaux conseillers de la Révolution tranquille au début des années 1960. Son rôle fut particulièrement manifeste dans la nationalisation d’Hydro-Québec, la création de la Caisse de Dépôt, la mise sur pied de la Société de financement du Québec, et l’instauration d’un nouveau système de négociation collective dans la fonction publique québécoise. Il apporta ainsi une contribution essentielle à la modernisation de l’économie québécoise.
- Un économiste nationaliste
Très nationaliste, Parizeau se joignit en 1969 au PQ, parti indépendantiste nouvellement fondé. Il devint immédiatement l’un de ses principaux porte-étendards. Défait aux élections de 1970 et 1973, il se fit élire comme député en 1976, le nouveau premier ministre, René Lévesque, le nomma ministre des finances. Salué dans tout le Canada comme le seul véritable ministre des finances professionnel du pays, Parizeau apporta une crédibilité financière au nouveau gouvernement péquiste. Ici encore, il se démarqua par ses prises de positions économiques novatrices avec la création du Régime d’épargne-actions du Québec en 1979 et du Fonds de solidarité FTQ en 1983.
- Un économiste chef du PQ
Toujours le promoteur le plus entreprenant et le plus infatigable de l’indépendance du Québec en dépit de la défaite référendaire de 1980, il rompit avec Lévesque en 1984 sur la question du « Beau Risque », rejetant la perspective de ce dernier de donner une dernière chance au fédéralisme canadien. À la suite de la démission de Lévesque, Pierre-Marc Johnson devint premier ministre en 1985. Mais la défaite de Johnson aux élections de décembre 1985, le força à démissionner comme chef du PQ en 1987. Ayant refusé une nomination au sénat canadien, Parizeau put ainsi devenir en 1988 chef du mouvement indépendantiste, au moment où le Canada s’entre-déchirait dans les méandres de l’accord du Lac Meech. La perspective d’un accord constitutionnel permit à Robert Bourrassa de défaire Parizeau lors des élections de 1989.
Toutefois, l’échec de l’Accord du Lac Meech en juin 1990 remit la perspective indépendantiste à l’ordre du jour. Parizeau trouva un grand allié en Lucien Bouchard qui avait quitté le gouvernement fédéral pour fonder le Bloc Québécois. Face aux nouveaux pourparlers constitutionnels fédéraux, le Québec assista à la tenue de la Commission Bélanger-Campeau. Ces deux démarches aboutirent à la tenue du référendum entourant l’Accord de Charlottetown. Parizeau mena alors le camp du “non” à une victoire éclatante. La table était donc mises pour la tenue d’un référendum sur la souveraineté.
- Le référendum de 1995
Mais encore fallait-il que le PQ remporte les élections, ce qui fut fait mais de manière serrée en septembre 1994. Bien que les sondages soient devenus très défavorables, Parizeau proclame que les conditions étaient réunies pour tenir sa promesse, soit l’organisation d’un référendum en 1995. Dans un ultime effort pour renverser la tendance négative, Parizeau nomma au milieu de la campagne référendaire Lucien Bouchard, beaucoup plus populaire, comme leader du camp du “oui”. Néanmoins, le camp du “oui” perdit le référendum par 55 000 votes, soit 49,42% contre 50,58%. Visiblement amer, Parizeau fit une sortie intempestive blâmant l’influence financière et la mobilisation des communautés ethniques pour la défaite référendaire. Le lendemain il annonçait sa démission.
Toujours partisan convaincu de l’indépendance québécoise, Parizeau tentera d’insuffler un nouveau souffle au mouvement souveraineté en commentant périodiquement l’actualité québécoise et canadienne. Il n’hésitait pas à critiquer son propre parti, allant même à soutenir le nouveau parti indépendantiste de l’Option nationale en 2012. Bien que ses contributions au développement économique du Québec furent majeures, voire extraordinaires, beaucoup de personnes ne se souviennent aujourd’hui de lui que pour sa déclaration malheureuse de 1995.
Gilles Vandal, Ph.D
Professeur émérite de l’Université de Sherbrooke