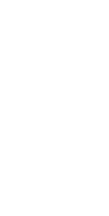- Qu’est-ce qu’une charte?
Avant l’adoption de la Charte, la protection des droits et libertés au Québec reposait principalement sur le Code civil, qui n’offrait pas de garanties explicites en matière de droits fondamentaux. L’idée d’une charte est née d’un important travail de mobilisation de la société civile, notamment de la Ligue des droits de l’Homme et d’intellectuels tels que Jacques-Yvan Morin. Inspirée par la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Charte québécoise a également influencé les rédacteurs de la Charte canadienne des droits et libertés de 1982.
La Charte québécoise détient un statut supérieur à toutes les autres lois provinciales, ce qui signifie que toute loi québécoise doit s’y conformer. Toutefois, elle demeure subordonnée à la Constitution du Canada, qui inclut la Charte canadienne des droits et libertés.
- Une Charte adoptée à l’unanimité
L’adoption de la Charte a été le fruit d’un long processus mené par le ministre de la Justice du gouvernement libéral de Robert Bourassa, Jérôme Choquette, à partir d’octobre 1974. Le projet de loi a été adopté à l’unanimité en juin 1975 et est entré en vigueur en juin 1976. Depuis, la Charte a été modifiée à plusieurs reprises pour s’adapter aux nouveaux enjeux sociaux, par exemple avec l’ajout de l’orientation sexuelle (1977), de l’âge (1982) ou de l’identité et de l’expression de genre (2016), renforçant ainsi la protection des groupes historiquement marginalisés.
Grâce à la Charte, toutes les lois québécoises doivent désormais respecter les droits fondamentaux qu’elle consacre, assurant ainsi une protection accrue des citoyens.
- Les objectifs de la Charte
Le principal objectif de la Charte est de garantir l’égalité de tous les Québécois et Québécoises dans leurs rapports avec l’État, ses institutions et entre eux. Elle protège un large éventail de droits : civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Parmi les droits protégés, on retrouve la liberté d’expression, les droits linguistiques, le droit à l’instruction publique gratuite, le droit à des conditions de travail justes, et le droit à un environnement sain.
La Charte interdit également toute forme de discrimination fondée sur la race, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’âge, la religion ou la langue, entre autres. Elle a mis en place la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ainsi que le Tribunal des droits de la personne, offrant ainsi aux victimes de discrimination des recours spécialisés et accessibles. Contrairement à la Charte canadienne, la Charte québécoise prévoit des mécanismes institutionnels spécifiques pour la protection des droits.
- Une Charte inspirante
La Charte québécoise a établi un socle commun de valeurs et de droits, en matière d’égalité et de justice sociale, qui inspire encore aujourd’hui la société québécoise. Elle a permis de structurer la défense des droits de la personne et de promouvoir une culture du respect et de la dignité.
- Des défis à relever
Malgré ses avancées, la Charte doit continuellement s’adapter aux nouveaux enjeux sociétaux. Des inégalités persistent et l’accès aux recours demeure parfois difficile pour les personnes lésées. Par ailleurs, le gouvernement du Québec a parfois recours à la clause dérogatoire pour soustraire certaines lois à l’application de la Charte canadienne, comme ce fut le cas avec la Loi sur la laïcité de l’État (loi 21), ce qui suscite d’importants débats sur la portée et la protection des droits fondamentaux.
Luc Guay, Ph.D
Professeur retraité de l’Université de Sherbrooke