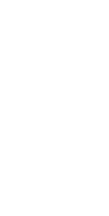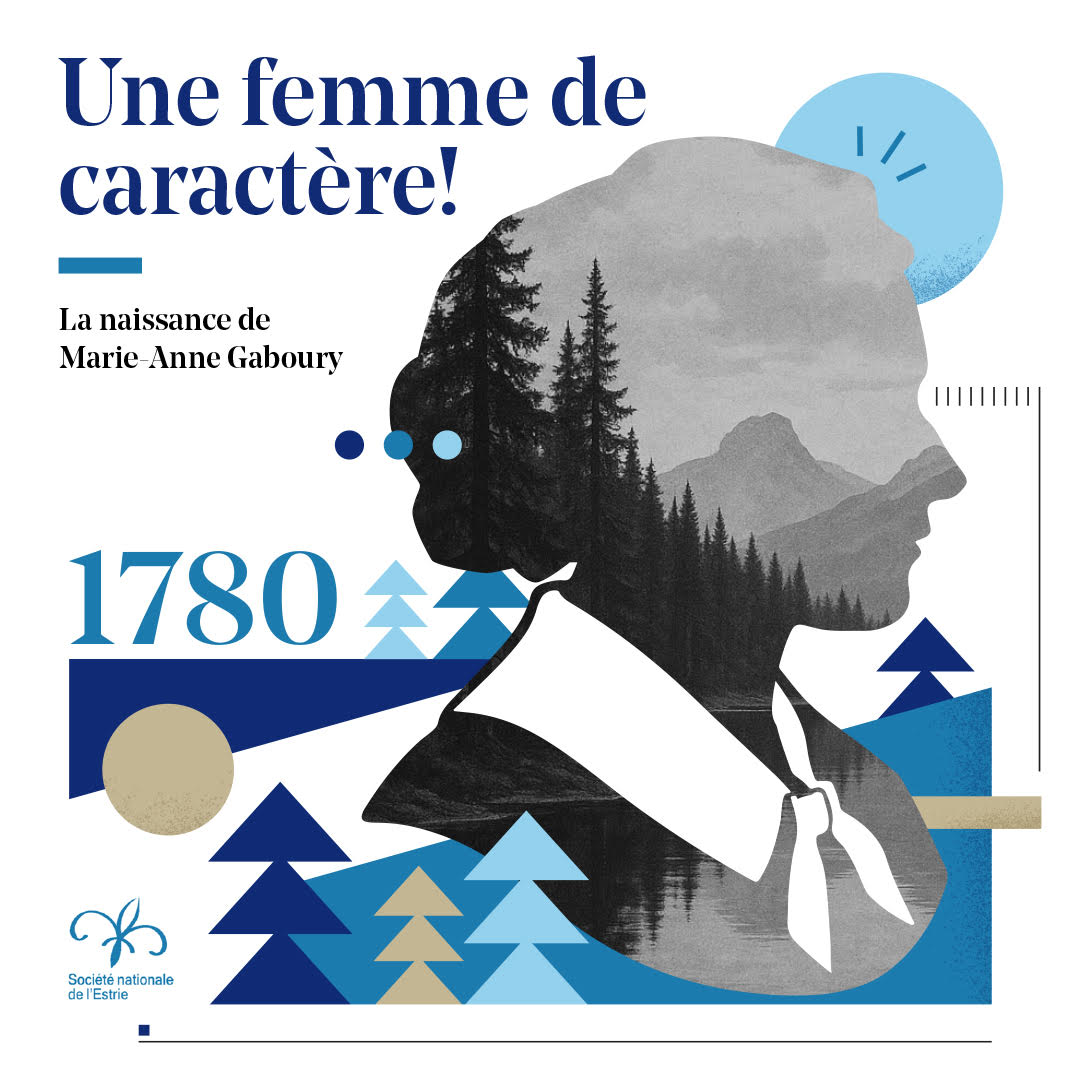Le nom de Marie-Anne Gaboury demeure peu connu du grand public, mais il revêt une importance particulière pour les habitants de l’Ouest canadien et pour son petit-fils, Louis Riel, figure marquante à l’origine de la fondation du Manitoba. Marie-Anne Gaboury est reconnue comme une pionnière de l’établissement des colons non autochtones dans cette région du pays.
- Quitter le Québec pour l’Ouest canadien
Née le 15 août 1780 à Louiseville, au Québec, Marie-Anne Gaboury est la cinquième d’une famille de dix enfants. Après le décès de son père en 1792, alors qu’elle n’a que douze ans, elle devient domestique chez le curé de Maskinongé, où elle apprend à lire, à écrire et compter. En 1806, elle épouse Jean-Baptiste Lagimodière, un coureur des bois indépendant pour le compte de la Compagnie du Nord-Ouest, concurrente de la Compagnie de la Baie d’Hudson, et décide de l’accompagner dans l’Ouest canadien, une démarche exceptionnelle pour une femme de son époque.
Dès leur mariage, le couple quitte le Québec pour s’installer dans la région de la rivière Rouge, après un périple éprouvant de cent jours en canot ponctué de nombreux portages. Ils s’établissent d’abord à Pembina (Dakota du Nord), puis dans la vallée de la rivière Saskatchewan et jusqu’à Edmonton, partageant leur vie avec les Métis et les Premières Nations. Marie-Anne Gaboury donne naissance à neuf enfants, dont Julie, la mère de Louis-Riel.
- De nombreux défis à relever
Marie-Anne Gaboury doit affronter des défis considérables. Sur le plan physique, elle partage la vie rude des coureurs des bois, effectue de longs voyages en canot, vit dans des conditions précaires et met au monde ses enfants loin de toute infrastructure médicale. Elle est la première femme non autochtone à s’établir aussi loin à l’Ouest, dans des territoires alors habités principalement par les Métis et les Premières Nations.
Les épreuves psychologiques sont également nombreuses : elle vit au coeur des rivalités entre la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la Baie d’Hudson pour le contrôle du commerce des fourrures, et doit composer avec les tensions croissantes entre l’arrivée de nouveaux colons, les Métis et les Premières Nations, alors que l’arrivée des premiers colons bouleverse l’équilibre du territoire.
- Des premières pour une femme de caractère
Marie-Anne Gaboury est la première femme blanche à s’installer durablement dans la région comprise entre la rivière Rouge (Manitoba) et Edmonton (Alberta). Elle donne naissance au premier enfant non autochtone en Saskatchewan, puis en Alberta, et devient la marraine de nombreux enfants, autochtones et non autochtones, lors de baptêmes catholiques.
Témoin privilégiée des bouleversements de l’Ouest, elle assiste à la naissance du Manitoba en 1870, trois ans après la création de la Confédération canadienne, et aux revendications et aux luttes menées par son petit-fils Louis Riel lors de la résistance métisse face aux politiques de déportation du gouvernement canadien. Marie-Anne Gaboury s’éteint à Saint-Boniface (Winnipeg), le 14 décembre 1875, à l’âge vénérable de 95 ans, sans jamais être retournée dans la vallée du Saint-Laurent.
On se souvient d’elle aujourd’hui comme de la « grand-mère de la rivière Rouge » et une figure emblématique de la francophonie de l’Ouest canadien.
Luc Guay, Ph.D
Professeur retraité de l’Université de Sherbrooke