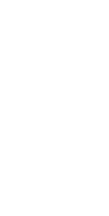Les années 1970 au Canada furent marquées par une crise constitutionnelle centrée sur les revendications du Québec pour une place plus équitable dans la fédération canadienne. Cette crise mena au référendum de mai 1980, où le « non » l’emporta, avec la promesse de répondre aux demandes québécoises.
1. Le rapatriement unilatéral de la Constitution
En 1981, le gouvernement Trudeau renia sa promesse et procéda au rapatriement unilatéral de la Constitution canadienne, incluant une Charte des droits. Le Québec fut exclu de cette démarche, lors de la fameuse « nuit des longs couteaux ». Le gouvernement Lévesque refusa d’approuver le nouvel ordre constitutionnel, mais la Cour suprême confirma la légalité de la Loi constitutionnelle de 1982 au Québec. Un sentiment de trahison s’installa alors chez les francophones québécois.
2. Les bases de la réintégration du Québec
En 1984, Brian Mulroney et les conservateurs remportèrent les élections fédérales avec la promesse de réintégrer le Québec dans la Constitution « dans l’honneur et l’enthousiasme ». Le gouvernement Bourassa, élu en 1985, partageait cette volonté de réconciliation nationale. Mulroney et Bourassa, pragmatiques et cordiaux, s’entendirent sur cinq conditions pour que le Québec signe la Constitution de 1982 : reconnaissance du caractère distinct du Québec, droit de veto constitutionnel, participation à la nomination des juges de la Cour suprême, sélection des immigrants et possibilité de retrait de nouveaux programmes fédéraux avec compensation financière. Ces demandes étaient jugées modérées et susceptibles de rallier les autres provinces.
3. La négociation des accords du Lac Meech
Le 30 avril 1987, Mulroney réunit les premiers ministres provinciaux au Lac Meech, à huis clos. Après neuf heures de négociation, un consensus fut trouvé sur une réforme constitutionnelle intégrant les cinq demandes du Québec. L’accord, simple et compréhensible, semblait promettre la paix constitutionnelle et la pleine réintégration du Québec. Les premiers sondages montraient un large appui, et les chefs de l’opposition fédérale soutenaient l’accord. Mais rapidement, l’opposition s’organisa.
4. L’organisation et la consolidation de l’opposition
L’ancien premier ministre Trudeau dénonça l’accord comme une menace à l’unité canadienne. Les premiers ministres de l’Ontario et du Manitoba exprimèrent des réserves, ce qui mena à de nouvelles négociations. Malgré la signature officielle le 3 juin 1987, l’opposition persista, critiquant le processus opaque et la notion de « société distincte » qui, selon eux, déséquilibrait la fédération. Des groupes féministes, autochtones, et des provinces de l’Ouest et de l’Atlantique exprimèrent aussi leur mécontentement.
Le gouvernement Mulroney ne pressa pas les provinces de ratifier rapidement l’accord, ce qui permit à l’opposition de se renforcer. Le consensus se brisa à l’automne 1987 avec l’élection de nouveaux gouvernements au Nouveau-Brunswick et au Manitoba, puis avec le rejet de l’accord au Sénat. L’utilisation par le Québec de la clause dérogatoire pour protéger la loi 101 accentua la méfiance du reste du Canada. En 1989, l’arrivée de Clyde Wells comme premier ministre de Terre-Neuve ajouta un nouvel opposant.
5. Le rapport Charest et l’échec final
En mars 1990, trois provinces n’avaient toujours pas ratifié l’accord. Mulroney créa un comité, dirigé par Jean Charest, pour trouver un compromis. Le rapport Charest proposa de subordonner la clause de société distincte à la Charte, mais Bourassa refusa. Lucien Bouchard démissionna alors du gouvernement Mulroney. Une dernière conférence des premiers ministres aboutit à un second accord, mais les premiers ministres du Manitoba et de Terre-Neuve restèrent opposés.
Le 22 juin 1990, faute de ratification au Manitoba, Terre-Neuve refusa aussi de voter. L’accord du Lac Meech échoua. Bourassa prononça alors son célèbre discours sur un « Québec libre de ses choix ». Le 24 juin 1990, une immense foule manifesta à Montréal, marquant un sommet du nationalisme québécois et la conviction, pour beaucoup, que l’indépendance du Québec était désormais à portée de main.
Gilles Vandal
Professeur émérite de l’Université de Sherbrooke