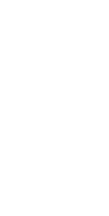Il y a 45 ans, la population du Québec fut sondée sur sa volonté ou non de choisir la souveraineté-association avec le Canada comme projet de société. Le Parti Québécois, élu pour la première fois à la tête de l’Assemblée nationale le 15 novembre 1976, était dirigé par René Lévesque et défendait l’option du OUI. Du côté du NON, le chef Québécois était Claude Ryan, et formait l’opposition à l’Assemblée nationale. Les deux camps s’affrontèrent de la mi-mars au 20 mai 1980.
1. L’option du OUI a le vent dans les voiles
Quelques mois plus tôt, Joe Clark alors Premier ministre du Canada, avait consenti à ce que le Parlement fédéral ne se mêlerait pas de la question référendaire; mais quelques semaines plus tard, il fut défait sur un vote de confiance : les élections furent annoncées et Pierre-Elliot Trudeau revint sur la scène fédérale comme Premier Ministre du Canada en février 1980. Ce dernier s’employa à pourfendre les tenants du OUI et nomma Jean Chrétien à la tête des forces fédérales du NON. Mais surprise : de la mi-mars à la mi-mai, des sondages montrèrent que le OUI l’emportait sur le NON (47% contre 44%, puis 54% contre 46% à la mi-avril, et enfin 52% contre 48% à la mi-mai). Il n’en fallait pas plus pour que les forces du NON s’engagent plus à fond en tablant, entre autres, sur une stratégie politique susceptible de renverser la tendance qui se dessinait.
2. L’option du NON l’emporta
Cette stratégie était à l’effet de proposer aux Québécois une réforme de la Constitution canadienne ayant pour effet de protéger les intérêts du Québec, et même, d’un rapatriement de la Constitution qui se trouvait jusqu’alors, à Londres. Cette promesse visait à réformer le fédéralisme canadien et à rapatrier la Constitution tout en y intégrant une Charte des droits et libertés. De plus, une phrase maladroite prononcée par la ministre péquiste de la condition féminine, Lise Payette, ajouta des munitions au camp du NON. En effet, celle-ci avait affirmé que la femme québécoise était émancipée et non plus soumise comme on la représentait encore dans des manuels scolaires sous le nom d’Yvette. Elle avait ajouté que la première était favorable à la souveraineté, alors que la seconde ne l’était pas. Après que les médias eurent rapporté ces propos, des milliers de femmes de partout au Québec manifestèrent leur mécontentement, ne supportant pas d’être considérées comme soumises si elles ne votaient pas OUI au référendum portant sur la souveraineté-association. À partir de ce moment-là, le camp du NON prit son élan, et ce, jusqu’à la soirée du 20 mai où le NON l’emporta avec 59,5% des suffrages exprimés. Le camp du OUI dut se contenter de 40,5%. Et chose intéressante à noter, la participation de la population s’était élevée à 86%!
3. « À la prochaine fois »
Plusieurs ont émis des réserves sur la question référendaire : d’abord les tenants du NON, la considéraient ambiguë, ne la trouvaient pas suffisamment « claire » quant au pourcentage que devait obtenir le camp du OUI s’il l’emportait, alors que dans la population, on la trouvait trop « longue ». Certaines personnalités du camp du OUI comme Jacques Parizeau, trouvait qu’elle manquait de simplicité. Soulignons que la question référendaire comptait sept lignes!
Lorsque les résultats furent connus, René Lévesque termina son discours en disant : « Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire : à la prochaine fois ».
4. La réélection du Parti Québécois
Que se passa-t-il aux élections québécoises de 1981? Eh bien, le Parti Québécois de René Lévesque conserva le pouvoir en faisant élire 80 députés contre 42 pour le Parti Libéral dirigé par Claude Ryan. Lévesque avait réussi à faire élire neuf députés de plus qu’en 1976, et obtint un meilleur pourcentage de voix, soit 49% contre 41% en 1976. Que comprendre de tout cela?
Luc Guay Ph.D
Professeur retraité de l’Université de Sherbrooke